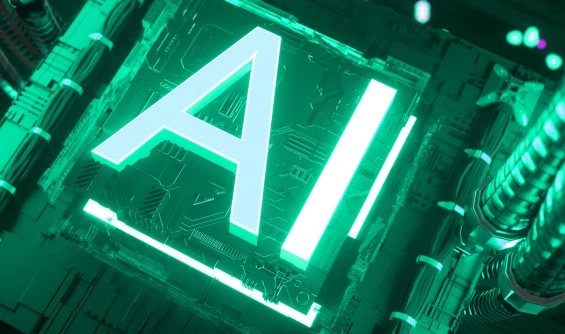L’intelligence artificielle peut-elle être responsable sans une infrastructure maîtrisée ? Cette question, en apparence technique, soulève en réalité l’un des défis stratégiques majeurs du numérique français et européen. Martin Dargent, fondateur d’EasyVirt, et Mickaël Garnier, directeur adjoint de DRI, ont accepté de nous livrer leur vision dans une interview croisée qui redéfinit les contours d’une IA véritablement soutenable.
Le constat de départ est clair : l’empreinte énergétique du numérique ne cesse de croître, et l’IA en est l’un des moteurs les plus puissants. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2025), la consommation électrique mondiale des centres de données devrait atteindre 945 TWh en 2030, soit près de 3 % de la consommation totale d’électricité dans le monde. C’est plus que la production totale d’électricité de la France en 2024 (539 TWh) et davantage que la consommation annuelle du Japon. Cette explosion énergétique s’explique en grande partie par les usages liés à l’IA, dont la chaîne complète (entraînement des modèles, stockage, refroidissement…) est particulièrement énergivore, même lorsqu’elle repose sur des sources bas carbone.
L’AIE alerte par ailleurs sur une concentration préoccupante des infrastructures : les États-Unis, l’Europe et la Chine concentrent à eux seuls 85 % de la consommation électrique des data centers. Aux États-Unis, cette seule industrie pourrait représenter près de la moitié de la croissance électrique du pays d’ici 2030, selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’agence.
Quant à l’IA elle-même, les ordres de grandeur donnent le vertige : d’ici 2030, un seul entraînement de modèle IA pourrait consommer autant que 8 réacteurs nucléaires, souligne le rapport. À ce jour, aucune exigence environnementale contraignante n’a été intégrée dans l’AI Act européen, et la dynamique politique reste focalisée sur l’attractivité industrielle, comme l’a montré le Sommet pour l’action sur l’IA tenu à Paris en février dernier. « Plug, baby, plug » lançait alors Emmanuel Macron, dans un appel assumé à la construction de nouveaux data centers sur le territoire français.
Dans ce contexte, penser une IA responsable sans une infrastructure sobre et pilotée semble illusoire. C’est d’ailleurs l’angle d’attaque qu’ont choisi EasyVirt et DRI dans leur démarche conjointe.
Souveraineté numérique : reprendre le contrôle de nos données
La première bataille se joue sur le terrain de la souveraineté. La dépendance des entreprises françaises aux solutions cloud américaines pour leurs projets d’intelligence artificielle représente une perte de contrôle stratégique sur des actifs numériques devenus critiques. Cette situation pose des questions majeures de confidentialité, de réversibilité et de conformité réglementaire.
Mickaël Garnier, de DRI, a fait le pari inverse avec Datagrex, son data center souverain implanté en France. « Nous avons conçu cette infrastructure autour de technologies open source pour garantir une indépendance technologique complète », explique-t-il. Cette approche permet aux entreprises de déployer leurs modèles d’IA dans un cadre juridique maîtrisé, avec la garantie d’une conformité RGPD native et la possibilité de rapatrier leurs données à tout moment.
L’enjeu dépasse la simple conformité réglementaire. Il s’agit de permettre aux organisations françaises de développer leur intelligence artificielle sans compromettre leur autonomie stratégique. Une logique qui trouve un écho particulier dans les secteurs sensibles comme la banque, la santé ou la défense, où la localisation des données conditionne directement la capacité d’innovation.
Cybersécurité : l’épuration comme stratégie défensive
Le deuxième pilier de cette approche concerne la sécurité. L’inflation des infrastructures IT a multiplié les vulnérabilités plutôt que de les réduire. Les ressources oubliées ou mal configurées représentent une part significative des failles de sécurité : machines virtuelles fantômes, stockages orphelins, services redondants.
Martin Dargent, fondateur d’EasyVirt, a développé une philosophie radicalement différente avec sa solution DC Scope®. « Nous partons du principe qu’une infrastructure complexe est une infrastructure vulnérable », résume-t-il. Son approche consiste à identifier et éliminer systématiquement les excès, révélant généralement des possibilités d’optimisation importantes tant en termes de sécurité que de coûts.
Cette stratégie d’épuration n’est pas qu’une optimisation technique. Elle constitue un véritable changement de paradigme sécuritaire. Plutôt que d’empiler les couches de protection sur une infrastructure gonflée, l’idée consiste à construire une architecture intrinsèquement plus sûre parce que plus simple et mieux maîtrisée.
Impact environnemental : des chiffres qui imposent l’action
Le troisième défi concerne l’empreinte environnementale directe de l’intelligence artificielle, et les chiffres sont sans appel. L’entraînement du modèle GPT-3 a généré à lui seul 552 tonnes de CO2 et consommé 1 287 MWh (soit 1,287 GWh) d’électricité, selon les données publiées par MIT Technology Review. Plus récemment, l’entraînement de ChatGPT a produit 502 tonnes d’équivalent CO2. Côté usage, une requête envoyée à ChatGPT génère en moyenne 0,382 gramme de CO2, contre 0,2 gramme pour une recherche Google, comme le souligne une analyse de Time Magazine. Ces données rappellent que l’empreinte environnementale de l’IA ne se limite pas à l’infrastructure, mais s’étend aussi aux usages du quotidien.
À l’échelle nationale, les projections sont tout aussi préoccupantes. Selon le rapport conjoint de l’ADEME et de l’ARCEP publié en janvier 2025, le numérique pourrait générer 50 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2050, si aucune mesure forte n’est engagée. Cela représenterait un triplement des émissions de gaz à effet de serre du secteur par rapport à aujourd’hui. Déjà en 2024, le numérique était responsable de 11 % de la consommation électrique française, un chiffre largement porté par les équipements, les réseaux et les centres de données.
Datagrex répond à ce défi avec des performances remarquables grâce notamment à un système de refroidissement sans climatisation. Mais au-delà des performances techniques, c’est surtout l’approche de mesure qui fait la différence. La solution CO2 Scope® permet un suivi en temps réel des émissions, transformant la gestion environnementale d’une contrainte subie en un levier d’optimisation active.
« Nous avons observé des réductions significatives d’empreinte carbone par rapport aux solutions cloud classiques », précise Mickaël Garnier. Cette performance s’explique par la combinaison de l’efficacité énergétique du data center et de l’optimisation continue des ressources. Une démonstration que sobriété et performance peuvent être réconciliées.
Gouvernance : l’infrastructure comme actif stratégique
Le quatrième pilier transforme la perception même de l’infrastructure. Trop longtemps considérée comme un centre de coût, elle devient un actif stratégique pilotable et optimisable. Cette transformation passe par une approche méthodique : mesurer les performances réelles, visualiser les données dans des tableaux de bord, proposer des optimisations factuelles, faire passer à l’action sur les gaspillages identifiés, et éclairer les décisions stratégiques par la donnée.
Cette méthode trouve des applications concrètes dans de nombreux secteurs. Dans la banque, elle permet de déployer des modèles de détection de fraude tout en maintenant la confidentialité des données clients. Dans la pharmacie, elle accélère la recherche médicamenteuse assistée tout en respectant les contraintes réglementaires strictes. Pour les administrations publiques, elle garantit la souveraineté des services numériques tout en optimisant leur impact environnemental.
L’interview qui change la donne
Martin Dargent et Mickaël Garnier ont accepté de décrypter les coulisses de cette approche dans une interview de 2 minutes et 38 secondes. Ils y expliquent pourquoi l’infrastructure détermine le destin de l’intelligence artificielle, comment concilier concrètement performance et responsabilité, et quels résultats tangibles peuvent être obtenus.
Cette conversation, disponible en vidéo, illustre parfaitement leur philosophie commune : l’intelligence artificielle responsable n’est pas un concept marketing mais une réalité technique exigeante. Elle suppose de choisir l’excellence technique plutôt que la facilité commerciale, et de considérer chaque décision d’infrastructure comme un arbitrage stratégique.
Trois actions pour commencer dès maintenant
Pour les organisations qui souhaitent s’engager dans cette voie, trois actions immédiates se dessinent. La première consiste à auditer l’infrastructure existante pour identifier les ressources inutilisées et mesurer l’efficacité énergétique réelle. Cette analyse révèle généralement des possibilités d’optimisation importantes avec un retour sur investissement rapide.
La deuxième action vise à évaluer les dépendances technologiques et à calculer les risques liés à l’externalisation des données critiques. Cette analyse permet d’envisager une stratégie de souveraineté progressive, adaptée aux enjeux spécifiques de chaque secteur.
La troisième action concerne le pilotage de l’empreinte environnementale avec des outils de mesure précis. L’objectif est de transformer la gestion de l’empreinte carbone d’une obligation réglementaire en un avantage concurrentiel.
Vers un nouveau modèle français
Au terme de cette analyse, une conclusion s’impose : l’intelligence artificielle responsable n’est pas un oxymore. Elle exige simplement de faire des choix techniques cohérents et souverains. Les entreprises qui maîtrisent leur infrastructure aujourd’hui prennent une longueur d’avance déterminante pour demain.
La France dispose des compétences, des technologies et des acteurs pour développer son propre modèle d’intelligence artificielle responsable. L’approche défendue par EasyVirt et DRI en fournit les bases techniques et méthodologiques. L’enjeu consiste maintenant à transformer cette expertise en avantage concurrentiel durable.
Car dans un monde où la performance technique et la responsabilité environnementale convergent, les organisations qui sauront anticiper cette transformation seront celles qui définiront les standards de demain.
Pour aller plus loin : Découvrez l’interview croisée Martin Dargent × Mickaël Garnier par ici ⇣